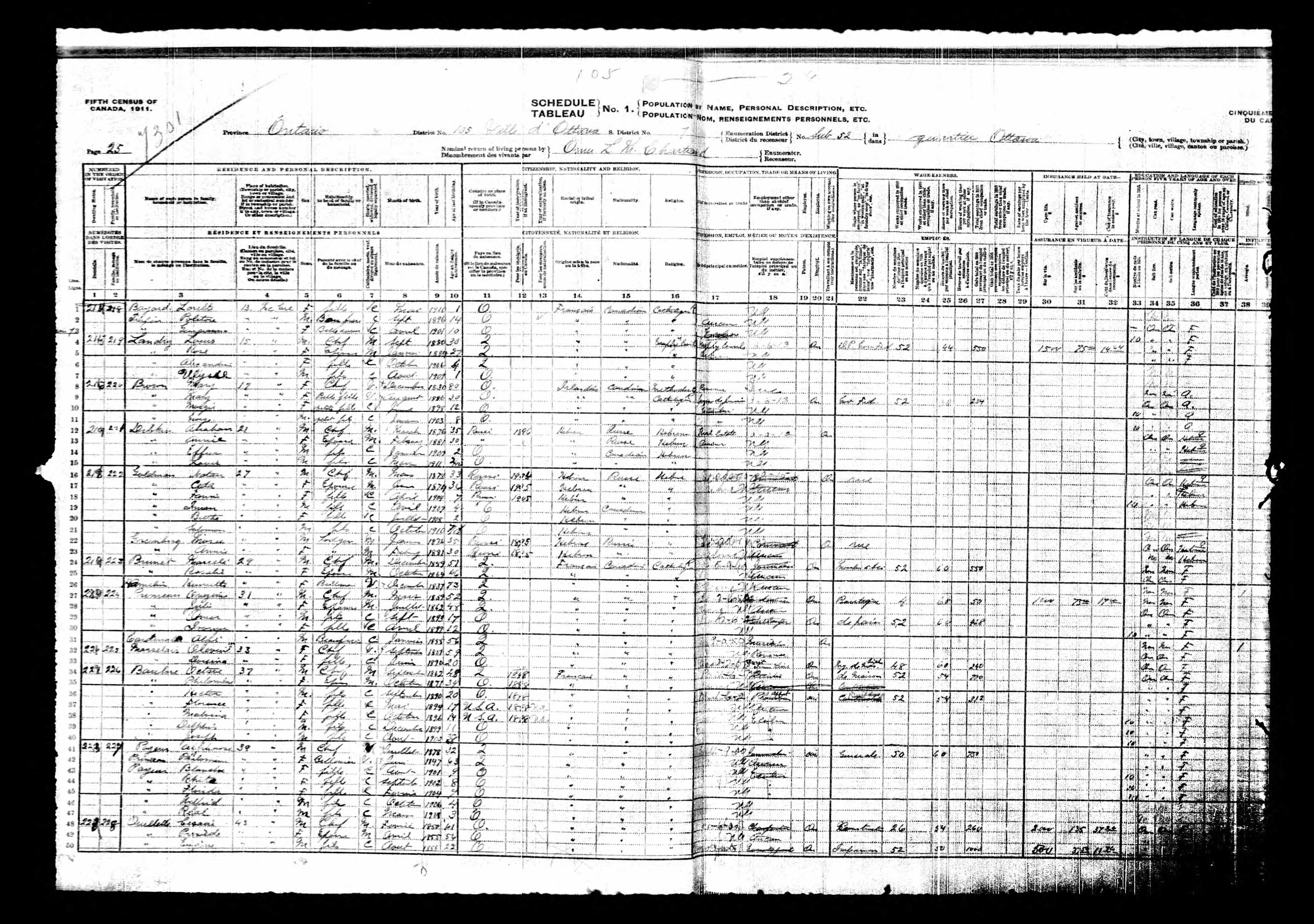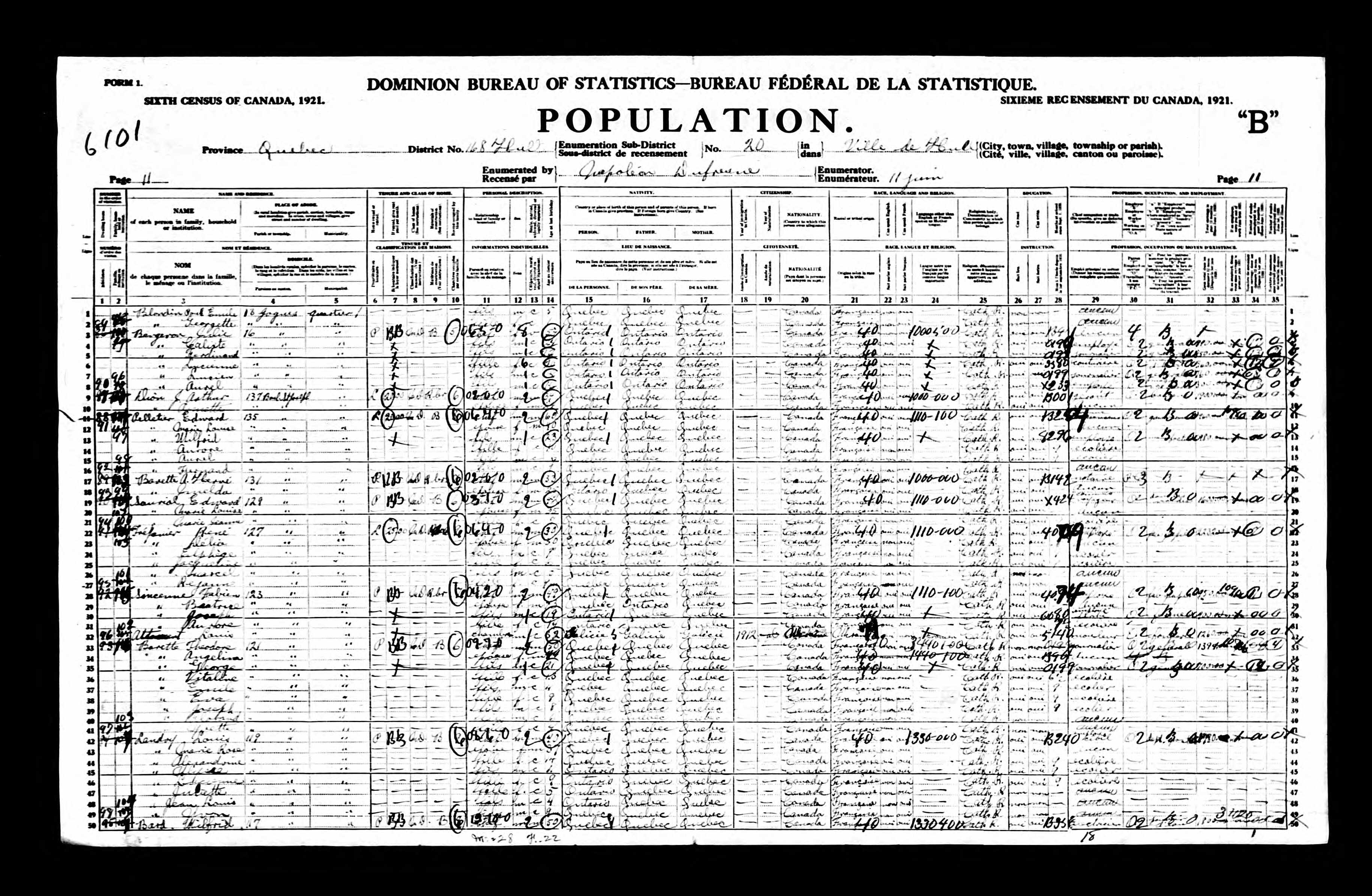|


| |
Histoire de René l'aîné à Jean-Louis Landry
1880-1938
1909-1920
Installation de la famille de Louis Landry au 15 rue McGee à Ottawa.
Recensement de 1911 à Ottawa
15 rue McGee, Louis, Rose,
Alexandrine, Ulysse Lignes 4 à 7
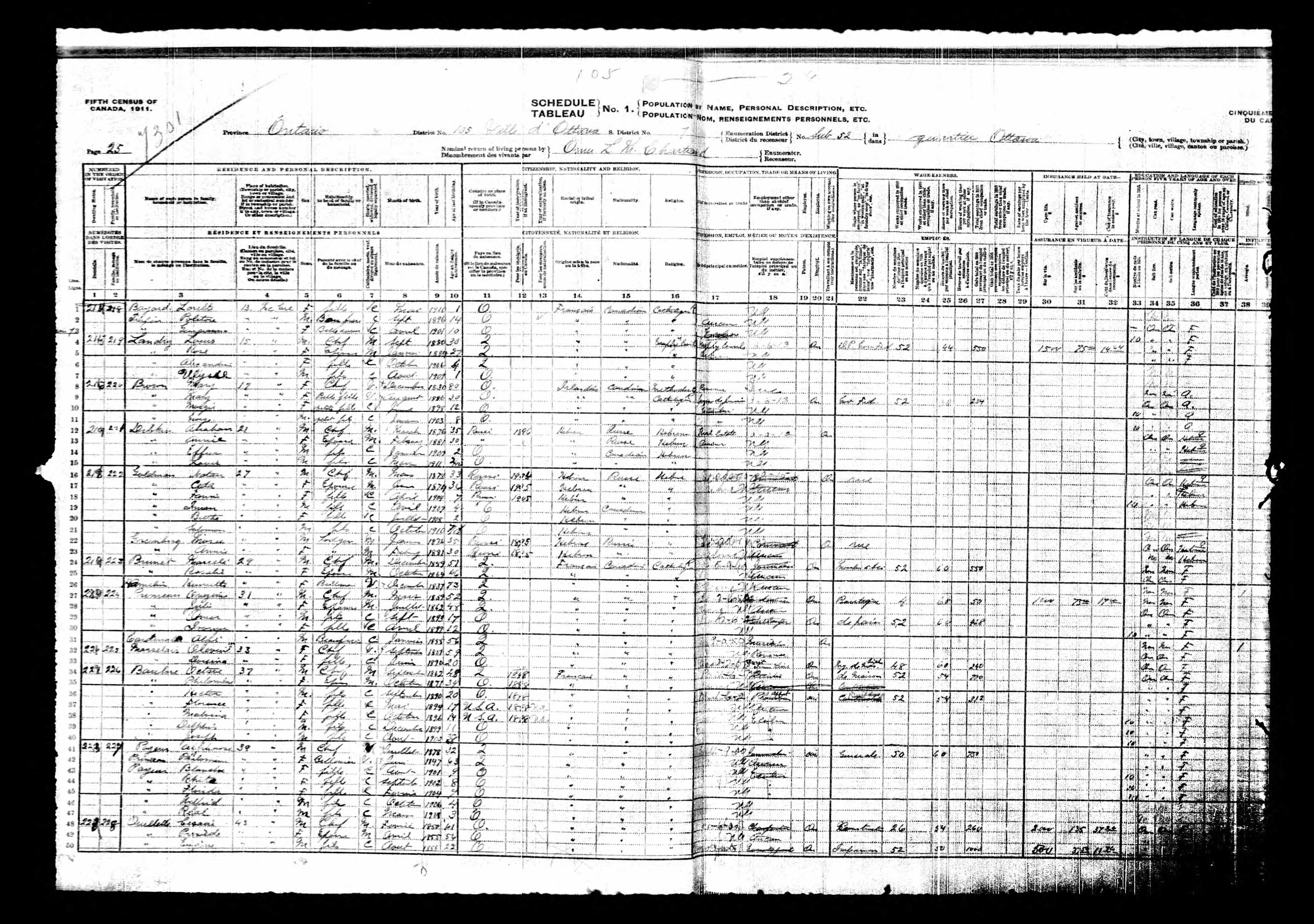
Naissance de Ulysse, Lucienne, Juliette et Jean-Louis
2 mars 1917 naissance de Jean-Louis, baptisé à la cathédrale Notre-Dame
d'Otawwa, le 4 mars.
Vers1920
Installation de la famille de Louis Landry au 119 boulevard Saint-Joseph à Hull.
Recensement de 1921 à Hull
Louis, Marie Rose, Alexandrine, Ulysse, Lucienne, Juliette, Jean-Louis, Yvon.
Lignes 42 à 49
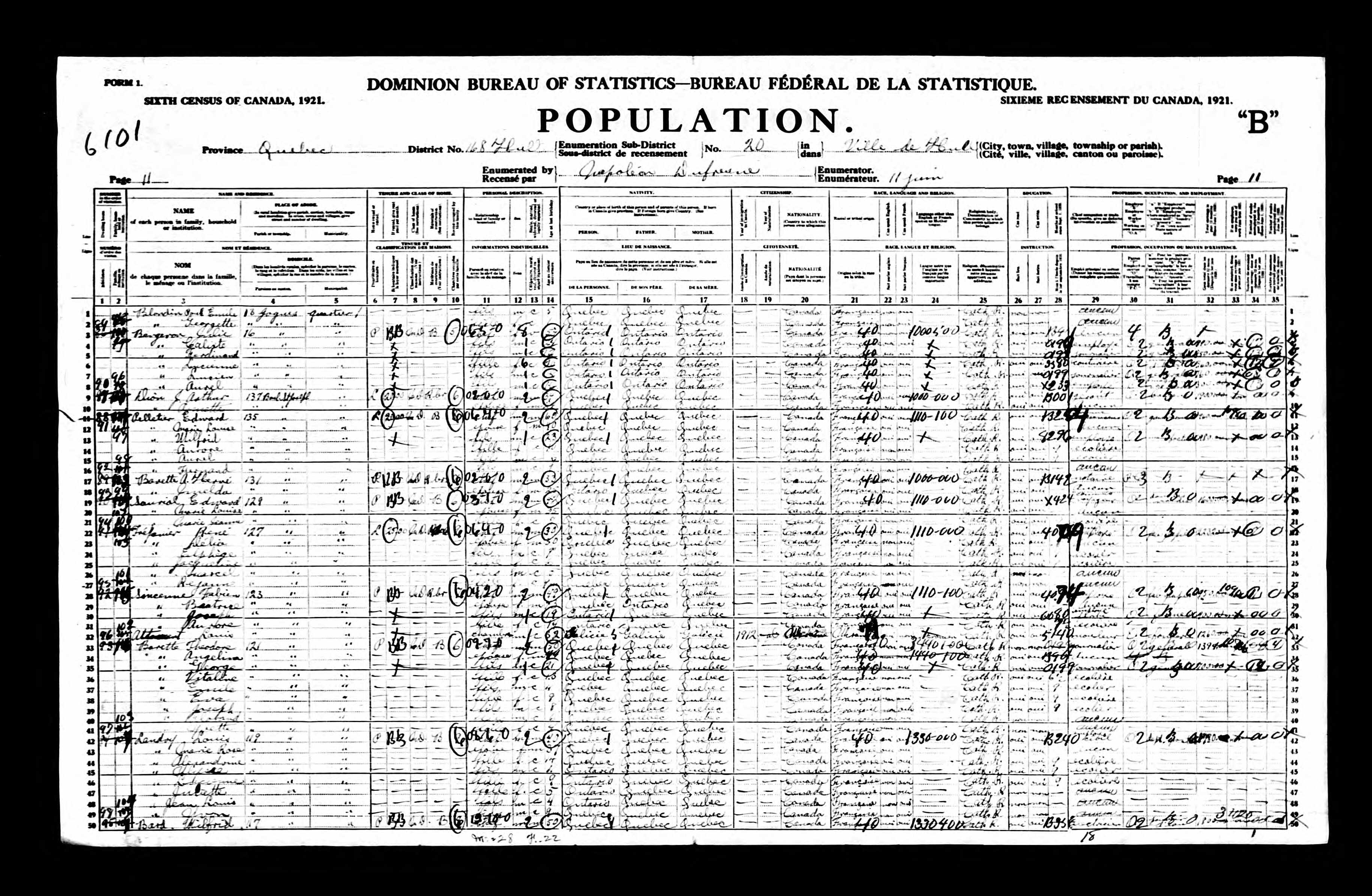
Naissance de Yvon, Rodolphe, Armand et Laurette.
1931-1937
Jean-Louis est probablement étudiant au Collège Saint-Alexandre de Limbourg alors dirigé par les pères du Saint-Esprit.
Durant cette période, Jean-François Pelletier y a été étudiant de 1931-1939. Voici ce qu'il en a écrit.
|
Si
j’ai opté pour Saint-Alexandre en 1931 à mes douze ans, c’est beaucoup
parce que mon frère Paul dut y aller faire ses rhéto et philo. Tous
deux pensionnaires, bien sûr, lui chez les « grands » et moi chez les «
petits ». Du reste, mes années de pensionnat ne virent, en tout et pour
tout, que trois externes à savoir les fils de Son Excellence Raymond
Brugère, ambassadeur de France : Jacques l’énigmatique, Daniel le dandy
studieux, puis ce cher Alain déjà gueulard et gavroche. Comment oublier
l’impressionnante limousine paternelle, d’allure quelque peu
plénipotentiaire, qui venait déposer le matin et reprendre le soir les
trois élèves Brugère qui toujours conservèrent, du Collège et du
Québec, un souvenir chaleureux voire ému. Je m’en suis bien rendu
compte lors d’un voyage à Paris en 1978.
S’ennuyer au collège me
paraît aberrant. Certes, j’eus quelques vifs désagréments aux mains des
Mamie, Grosse et LeBourrhis mais, dans l’ensemble, Saint-Alexandre
m’apporta huit années de bonheur quasi ininterrompu. J’y aimais tout.
D’abord, sa gaie façade en briques rouges et blanches, flanquée d’ailes
imposantes et coiffée d’un joli clocheton où trône, bavarde, son
horloge quadriface qui nous carillonnait l’heure, la demie et les
quarts, annonçant ainsi les grands moments de la journée - prière,
étude, repas et jeu. Des annexes et dépendances, j’ai surtout retenu le
charmant profil vieillot du pavillon des soeurs des Sacrés-Coeurs (lieu
tabou entre tous !), l’historique demeure du petit fils du fondateur de
Hull, un certain Alonzo Wright.
Pensez donc ! un collège en
pleine forêt laurentienne qu’on avait dû éclaircir, bien sûr, ici pour
aménager terrains de jeu et allées de promenade, là pour accommoder les
champs et communs d’une « vraie ferme » avec, au bout là-bas, la
sympathéque menuiserie du vieux M. Lutz à la grosse moustache. Mais ce
que les boisés alexandrins recelaient de plus alléchant, c’était sans
doute l’énorme érablière où chaque printemps nous allions trimer dur, à
tour de classe, pour « faire les sucres » d’abord mais pour ensuite
s’en repaître à en crever... Une lichette de tire chaude sur neige,
quel délice ! Brûle-gueule branlant au bec, le frère Jean (grand maître
des fourneaux) en souriait d’aise de sa bonne bouille édentée, tout en
surveillant d’un oeil connaisseur la riche sève aux vapeurs parfumées.
Effectivement légendaire par sa qualité qui faisait accourir toute la
région outaouaise, y compris les experts du Conseil national de
recherches, notre sirop d’érable devait beaucoup de son goût et de sa
technique, curieusement, à la France et à la Hollande transplantées ici
dans les personnes du frère Jean et du frère Chrysostome au doux visage.
En
bordure de cet insolite complexe collégial coulait la bondissante
Gatineau qui, en route vers Hull, caressait au passage notre grande île
Sainte-Marguerite reliée à la route par un mignon ponceau. Île
généreusement pourvue d’arbres, de sous-bois et de clairières, lieu de
prédilection pour les pittoresques leçons botaniques du bon père
Andlauer qui se reposait ainsi de son cours de chant où nous le
chahutions impitoyablement. Île où nous courions voir, certains jours,
les dessins fantastiques que traçaient les embâcles touffus, hérissés,
multiformes dressés ça et là par les billes en flottage libre ou
échappées de leurs trains de bois. Île aux sentiers ombreux menant à ce
fameux kiosque où les finissants venaient, un dernier soir,de juin,
nous faire leurs discours d’adieu et révéler leur choix de carrière
qui, parfois, surprenait quelque peu.
Le Saint-Alexandre d’il y a soixante-dix ans (2e partie)
Mes
meilleurs moments à Saint-Alexandre, je les dois peut-être à trois
choses : l’apprentissage de la parole, la magie du théâtre et, surtout,
à l’immense découverte du Petit Larousse. Dictionnaires et
encyclopédies me fascinent toujours et cette grande histoire d’amour
commença au Collège. C’est d’abord en salle d’études que le Petit
Larousse m’envoûta. Aussi fut-il le compagnon obligé de toutes mes
lectures (voire lecture en soi !), le précieux arbitre d’innombrables
débats parfaitement oiseux, l’étrange démêleur des matières préférées
et le remplaçant d’office des matières détestées. Si je vous disais que
l’exotisme du mot « hypoténuse » faillit me réconcilier avec les maths.
Ce mémorable Petit Larousse conserva toute son emprise même après que
ses jolies « pages roses » eurent été amputées de certaines
reproductions de statuaire classique, planches jugées scabreuses par un
pudique préfet de discipline. Façon comme une autre, je suppose,
d’interpréter Molière et son célèbre « Couvrez ce sein que je ne
saurais voir ! »
C’est Molière, justement, qui nous fournit en
mai 1936 notre pièce de fin d’année, « L’Avare ». Comme toujours, cette
production fut mise en scène par le père Daniel Barnabé, directeur
attitré de la troupe alexandrine. Fort satisfait de notre prestation,
il nous amena répéter « L’Avare » à Saint-Joseph d’Orléans près
d’Ottawa sortie exceptionnelle, vous pensez bien, pour les dix
pensionnaires que nous étions : Valmore Lafontaine, Hector Laflamme,
Bernard Potvin, Eugène Falardeau, Marc (Ovila) Saint-Jean, Clarence
Lesieur, Grégoire Farrell, Edmond Dumouchel, Marcel Chartier et moi qui
jouais Harpagon. J’avais dix sept ans. Mais déjà à quinze ans je
recevais l’honneur d’un autre premier rôle, celui de ce bravache qui
adore le vin et la gloire « Fanfan la Tulipe », pièce pleine de soldats
et de sauvages (42 acteurs !) jouée le 21 mai 1934 pour la fête de
Dollard. Fallait voir la joyeuse stupéfaction de la salle quand,
saluant soudain d’un geste large, Fanfan découvrait sa bille tondue
ras, effectivement scalpée par les Indiens - illusion rendue possible
par ma chevelure masquée sous une vraie vessie de boeuf !
Sur la
vingtaine de pièces jouées, deux autres méritent d’être signalées.
D’abord le « Thomas Morus » du 25 novembre 1937 où Marcel Chartier
(sauf erreur) incarnait si bien Thomas More, l’héroïque chancelier
exécuté par Henri VIII. J’y jouais le fidèle intendant de la maison
Morus, intendant peu convaincant alors que j’avais été un scélérat en
pleine forme dans « Le Nil rouge », super-production de mai 1935.
Remarquable reconstitution de l’ancienne Égypte, ce drame poétique fut
oeuvre conjointe, L’admirable professeur de rhéto qu’était le père
Henri Goré en créa le texte en fort beaux alexandrins, d’après un
savant canevas établi par ce fascinant égyptologue que fut le père
Louis Taché, titulaire de versification. Mon frère Paul compléta en
composant pour « Le Nil rouge » une aimable et habile musique qui
sentait presque les pyramides. Une riche distribution de 35 comédiens
mettait en vedette notre auguste aîné, Philippe Blanchard, le pharaon
dont je devenais le grand-prêtre, l’âme damnée et redoutable magicien
qui d’un coup de baguette fit surgir en scène de terrifiants feux de
Bengale ! Rôle de plusieurs centaines de vers qui révolta le père
Vichard à qui j’avais longuement expliqué que je n’arrivais pas à
apprendre son grec parce que je n’avais pas de mémoire... Ne quittons
pas les planches alexandrines avant d’y saluer le passage de tant
d’autres élèves acteurs, certains aussi doués qu’un Raymond Bériault,
d’autres aussi inattendus qu’un Alphonse Soucy ou un Rodrigue Roberge.
Et que dire de Philippe Maltais, congénitalement comique !
À
Saint-Alexandre, l’enrichissante fête de la parole revêtait moult
formes. En premier lieu, nos joyeuses soirées de famille où régnaient
chansons drôles et pitreries, saynètes loufoques et poèmes divers ; mes
prestations d’Hugo et de Jean Narrache y sont nées. Il y avait aussi le
passage de conférenciers de marque tels que l’explosif sénateur Gustave
Lacasse, l’éloquent bibliothécaire Félix Desrochers, l’éblouissant
sociétaire de la Comédie Française, Henri Rollan, qui semblait savoir
par coeur tout Racine et Corneille. Parfois on accueillait
solennellement d’éminents personnages comme le romancier John Buchan
(notamment « The 39 Steps ») devenu Lord Tweedsmuir, gouverneur-général
du Canada. Ou encore le comte Robert de Dampierre, ambassadeur de
France, dont la ravissante épouse Léïla était une poétesse yougoslave.
À la demande du père supérieur et à l’étonnement ému de l’auteur, je
lui dis en scène son beau poème « Séparation » obtenu subrepticement au
téléphone par le père Goré qui, à cet effet, avait appelé la secrétaire
de la Comtesse - la liant au secret ! N’oublions pas, surtout, les
exaltantes séances du cercle littéraire Montmorency-Laval que le père
Taché m’avait demandé de faire revivre avec lui, en 1936. Le dimanche
après la messe, sous l’oeil stimulant du Père, une vingtaine d’entre
nous s’y exerçaient au pur verbe français et aux arguments bien
charpentés : improvisations ou textes préparés, esquisses historiques,
corrections langagières, frémissants débats contradictoires où, du
premier coup, Philippe Blanchard me démolit net...
Le Saint-Alexandre d’il y a soixante-dix ans (3e partie)
La
musique aussi manifesta sa présence au Collège. En 1932, la schola
Saint-Ambroise coexistait avec les Chanteurs du Bon-Temps où se
faisaient valoir les folkloristes Tittley, Côté, Legault et Préseault
avec mon frère Paul au piano. Suivirent, en 1936, les Ménestrels de
Saint-Alexandre dirigés par le puissant ténor spiritain Frédéric
Heudes. Et qui peut oublier le violon d’Yvon Moranville et l’orgue du
frère Épiphane, coeurs vaillants et doigts trémulants ? Puisque nous
voilà à la chapelle, admirons les grandes toiles du sanctuaire ainsi
que l’autel central aux superbes pièces sculptées par M. Henri Lefebvre
d’Ottawa aidé de cet étonnant personnage que fut l’abbé Joseph Laurent,
professeur itinérant et omniscient s’il en fut. Cette belle chapelle où
le père Goré amenait ses rhétoriciens le premier vendredi du mois,
devant le Saint-Sacrement exposé, et où soudainement le Père
improvisait à voix haute les plus belles méditations que j’aie jamais
entendues. Chapelle d’où partait, un matin ensoleillé, la grande
procession de la Fête-Dieu dominée par notre supérieur à la barbe
virile. Avec cortège et sous dais, le père Droesch portait lentement
l’ostensoir le long d’un parcours précis où nous avions disposé, après
de longs travaux délicats, ces extraordinaires tapis faits de sciures
de bois agencées en dessins multiformes et multicolores, grâce à des
tamis et gabarits taillés et conservés à cette seule fin. Tapis de
sciures colorées, chefs-d’oeuvre éphémères, beautés d’un jour qui
pourtant durent toujours... dans ma mémoire !
Voilà que mes
réminiscences s’amenuisent et s’émiettent. Si je vous jetais en vrac
mes fonds de tiroirs-souvenir ? En supérieur qui se veut infirmier, le
père Droesch parcourt militairement les dortoirs où, parfois, il trouve
quelques « malades » authentiques... Érables rougis ou conifères
chargés de neige, inspiration première de mes premiers vers... Cette
troublante cave à vin (maison) que le frère Jean, échanson de service,
garde bien cadenassée... Monumentale glissoire démontable où, en luge,
nous glissions jusqu’au bout du monde... Douceur de l’increvable frère
Leutfried, dit Leufroy, qu’on prétendait « baptisé dans l’eau de
Cologne » (où naquit ce bel Allemand)... Forte supérieure surnommée
Babe Ruth, soeur Aimée gâtait les convalescents à coup de «
Corneflaques » prononcé à la française... Patinoires et ski, tennis et
balle-au-mur, anneaux du saut périlleux souvent raté... Entendre le
missionnaire Gérard Roy revêtir le banal « Ainsi soit-il » du seul sens
qui sied... Fiévreuses séances de cinéma, en salle de récréation, où
chaque film révélait invariablement un maximum de grosse action et un
minimum de bel amour (ben, voyons donc !)...
Au réfectoire après
chaque repas l’original frère Marie-Gilles, « Ti-Potte » pour les
intimes, lave ses tonnes de tasses et discute astrologie...
Admirer-qu’un père Gauchet soit aussi bon photographe (nos albums
regorgent de ses oeuvres) qu’élégant patineur de fantaisie... Le préfet
tenu d’initialer tout livre venu de l’extérieur, en guise
d’imprimatur... Charme printanier des longues rangées de serres plates
et basses, à châssis vitrés, où le frère Théodore dorlotait ses
primeurs potagères... La croix du chemin, face au pont Wright...
Crucifiantes leçons de choses du père Ratier en Belles-Lettres, étalant
au grand jour notre lamentable ignorance du français... La formatrice
mais énervante lecture qu’à tour de rôle il nous fallait faire au
réfectoire des pères, d’une voix mal assurée et d’une estrade trop
élevée - fouilli de textes français et latins où l’hermétisme le
disputait à la platitude... Obscénité involontaire des pères (français)
nous traitant de « gosses »... Scatologie volontaire du servant de
table Eugène Falardeau nous parlant du populaire « chiard »... Le père
Peghaire qui, furtivement, demande à mon frère Paul de lui jouer du
Debussy... Puissant professeur de philo que ce Peghaire qui tolérait
fort bien qu’on soutienne Duns Scot contre Thomas d’Aquin, la primauté
de la volonté sur l’intelligence et de la croyance sur le savoir !...
Perdurable ravissement d’entendre les pères (français) voussoyer le
dernier des morveux - authentique témoignage d’un respect et d’une
civilité que le Québec d’aujourd’hui comprend et pratique moins que
jamais...
Ferveur sportive du 3 mai, fête patronale de saint
Alexandre, et ferveur nationale du 24 mai, fête de Dollard... Le
supplice printanier de voir défiler, juste de l’autre côté de la
clôture, les belles filles d’la ville en route vers notre cabane à
sucre ; leur parler ? mein Gott, verboten !... Grégoire Farrell qui,
même couronné du prestigieux Prince-de-Galles, conserve sa fulgurante
maîtrise au dactylo... Ce journal personnel que le père Goré exigeait
de ses rhétoriciens et où j’osai préférer Rostand à Racine... Les
éruptions oratoires d’un Pierre Lauzé, suivies des obscures clartés
d’un Eugène Lavoie... Et cet autre Eugène, employé de ferme et
maître-cocher du temps des sucres Eugène Lévesque dont la force
herculéenne lui permet de soulever et décoincer, à lui tout seul,
l’arrière-train de son énorme traîneau à deux chevaux (où l’on
chargeait les tonneaux de sève)... Percevoir vaguement
l’invraisemblable humilité d’un Léo Leblanc... Rire sous cape de ces
conférences d’initiation sexuelle, d’accès très filtré, où chaque
moment crucial se dégonflait en inévitable : « Euh, vous savez c’que
j’veux dire ? »... Le bel éléphant de neige « sculpté » par l’équipe
Alain Brugère/Rodolphe Dumont/Eugène Lavoie... Amorce d’un contact avec
le père Eugène Andlauer, être exquis et racé dont l’amitié
vieillissante deviendra chose ineffable... Paul-Emile Proulx qui va
secrètement enduire de dentifrice les boutons d’interrupteurs au
dortoir, pour faire enrager l’exécrable surveillant qui chaque fois s’y
beurre en hurlant : « Qui donc a mis de la pâte sur le piton ? »
Le Saint-Alexandre d’il y a soixante-dix ans (4e partie)
Endiguons
le fleuve des souvenirs et tâchons de conclure, fût-ce de façon trop
personnelle. Que tentaient de faire, au juste, les prodigieux profs
Taché, Ratier, Goré, Peghaire et compagnie ? À travers toutes nos
activités collégiales, Saint-Alexandre cherchait essentiellement à nous
enseigner l’art de devenir homme, pleinement homme de coeur, de corps,
d’âme et d’esprit - des hommes adultes et donc responsables, soucieux
des vraies transcendances : beauté, bonté, sagesse et amour. Avoir soif
d’une liberté disciplinée ; que le fameux « Consacrer sa vie à la
vérité » ne soit pas simple slogan mais véritable mot d’ordre. Pour y
arriver, commencer par se vider de l’absurde prétention de savoir
quelque chose. (Car ne rien savoir et le savoir, c’est déjà beaucoup !)
Une fois le terrain déblayé, y bâtir patiemment la maison du coeur et
de l’esprit - chacun à sa façon - jusqu’à complète maturation de ses
virtualités propres. Chemin faisant, accepter le terrible poids de TOUT
penser et repenser pour soi, sans jactance mais sans crainte des dits,
on-dit et édits d’où qu’ils viennent y compris des « chefs » temporels
et spirituels. Revoir sans cesse ses propres « vérités » à la lumière
de celles des autres. Bref, acquérir une fois pour toutes ce fameux
esprit critique, à la fois courageux et pondéré, que tentaient de nous
insuffler la rigueur d’un Peghaire alliée à la finesse d’un Goré.
En
général, l’opération ne réussit qu’à force de longs efforts soutenus
par une foi passionnée en Dieu et en soi, mais attention ! le meilleur
de soi, celui qui se manifeste plus ou moins consciemment par la langue
et la culture. Hélas, la plupart d’entre nous ne voient même pas que la
langue constitue - et à proprement parler - l’étincelle de divinité qui
affleure dans l’homme. Aussi, pour nous au Québec, la langue et la
culture françaises sont-elles la principale composante de notre
personnalité collective. (À ceux qui regimbent je rappelle qu’être
français n’est pas nécessairement d’être Français... ) Par ailleurs,
personnalité collective fortement marquée au coin du spirituel - un
spirituel qui pourra parfois varier d’espèce, d’allégeance, mais jamais
d’intensité. Que là résident le bonheur et l’avenir de l’homme
québécois - comme de l’Homme tout court - demeure vrai au point où tout
le reste - argent, pouvoir, carrière, succès - sont comme n’étant
pas... Ce qui n’exclut en rien (bien au contraire !) un constant
émerveillement devant la compagne, les enfants, l’ami fidèle, un bon
vin et une belle musique, notre soeur l’eau et notre frère le soleil.
Notamment de ce soleil couchant que nous goûtions parfois au Collège
quand, rassemblés autour de la Grotte et de son ruisselet, nous
entonnions à pleins poumons le chant à la Vierge :
L’ombre s’étend sur la terre,
Vois tes enfants de retour
À tes pieds, auguste Mère,
Pour t’offrir la fin du jour.
O Vierge tutélaire,
O notre unique espoir,
Entends notre prière
La prière et le chant du soir !
P.S.
Mes excuses à ceux que j’aurais blessés en les omettant de ce faux
palmarès des « gloires de l’escole ». Mon coeur, lui, se souvient.
Puis, se redire le mot mélancolique de Peghaire : la mémoire, c’est la
faculté d’oublier... | |
Auteur
: Jean-François Pelletier, également né à Ottawa en 1917, décédé à
Montréal le 7 mar 1994. Élève de 1931 à 1939, membre du conventum
1937-1987. | |
Sources.
Article sur le Collège Saint-Alexandre
Archives de Jean-François Pelletier : https://pistard.banq.qc.ca
Wikipédia : Collège Saint-Alexandre
|
|
|
Marcel Walter Landry - Pour toute question ou problème concernant ce site Web,
envoyez moi un courriel.
Dernière modification
: samedi 08 novembre 2025
|